Quand le dédicataire d’un roman en achète tous les exemplaires pour les brûler
Lees een vertaling van hoofdstuk 1 van Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan in het Frans. En een inleidend essay van vertaler Daniel Cunin.
Issu d’une famille juive orthodoxe, pauvre et très nombreuse, Jacob Israël de Haan (1881-1924) devient enseignant à une époque où il a perdu la foi. Parallèlement, il fait ses armes comme journaliste dans la mouvance socialiste et poursuit de longues études de droit ; il soutiendra sa thèse en 1916.
En 1904, cependant, il connaît de graves difficultés après la parution de Pijpelijntjes, considéré, dans les lettres néerlandaises, comme le premier roman qui évoque sans retenue l’homosexualité masculine, ce qu’on appelait encore « uranisme ». L’ami auquel il dédie cette œuvre, Arnold Aletrino (1858-1916) – écrivain, sexologue et anthropologue criminel réputé –, se reconnaît dans Sam, l’un des deux protagonistes. Par crainte de voir sa réputation souillée, menacé en outre de perdre son emploi, il tente avec une consœur – la fiancée de Jacob Israël de Haan ! – d’acheter l’ensemble des exemplaires du premier tirage pour les détruire. Très peu de lecteurs ont donc eu accès au livre, devenu aujourd’hui un collector. Une édition revue – dans laquelle on ne reconnaît plus en rien les personnages principaux –, mais non pas « expurgée », est bientôt commercialisée.
J.I. de Haan
À cause de cette œuvre, De Haan perd son travail dans l’enseignement ainsi que son poste de rédacteur au sein d’un quotidien socialiste en vue (il était en charge de la rubrique hebdomadaire consacrée aux enfants). Après la parution de Pathologieën (1908), autre roman homo-érotique, il lui est encore plus difficile de trouver un emploi. L’un des rares à oser le soutenir publiquement, c’est Georges Eekhoud ; l’Anversois d’expression française, qui lit le néerlandais, écrit un avant-propos à Pathologieën. Il s’était auparavant exprimé en faveur de l’ouvrage « juste et courageux » de Jacob : « Dans un premier roman, Pijpelijntjes, l’auteur avait déjà traité de l’amour uraniste ou homogénique. Et ce livre très curieux et souvent excellent lui avait valu, parait-il, des persécutions de la part de certains pharisiens appartenant à un parti duquel on aurait été en droit d’attendre plus de compréhension et de tolérance. Les socialistes, dont M. De Haan était, l’auront répudié et même dénigré comme une brebis galeuse. » À la même époque, De Haan est lié à Remy de Gourmont auquel il rend quelques visites dont on trouve trace dans des revues ou sa correspondance. À ce propos, Jan Fontijn, le biographe du Hollandais, écrit : « Rédacteur au Mercure de France, Remy de Gourmont revêtait une telle importance pour De Haan que ce dernier alla le voir à Paris, rue des Saints-Pères. L’individualisme du Français, sa sensualité, ses conceptions libérales sur toutes les formes de sexualité, parmi lesquelles le sadomasochisme, l’intriguaient. Ces thématiques se retrouvent en grande partie dans le roman Ondergangen (Débâcles) de 1907 et plus encore dans le décadent Pathologieën paru l’année suivante. »
Vers 1912, De Haan effectue plusieurs voyages en Russie pour y visiter ses effroyables prisons. Par ailleurs, il devient membre du mouvement sioniste. Bientôt, il étudie l’hébreu et renoue avec la religion de son enfance, publiant à l’époque quelques recueils de poésie dans lesquels transparaissent les nouvelles conceptions auxquelles il adhère ; mais il donne aussi de longs poèmes inspirés d’œuvres d’Eekhoud ainsi que nombre de quatrains, certains d’une audacieuse teneur érotique.
À la fin des années dix, un quotidien amstellodamois envoie l’auteur en Palestine. Il laisse son épouse à Amsterdam. Dans ses articles, le correspondant prend peu à peu ses distances vis-à-vis du sionisme au point de finir par rompre avec lui en 1922. Menacé à plusieurs reprises, il est assassiné en 1924 à Jérusalem par un membre de cette mouvance politico-religieuse. En 1932, Arnold Zweig, ami de Freud, publie De Vriendt kehrt heim (Un meurtre à Jérusalem : l’affaire de Vriendt, Paris, Desjonquères, 1999), roman à clef sur les années palestiniennes de J.I. de Haan.
En langue française, on peut lire de Jacob Israël de Haan deux recueils d’articles et de reportages : De notre envoyé spécial à Jérusalem. Au cœur de la Palestine des années vingt (choix, présentation, notes et traduction du néerlandais par Nathan Weinstock, Bruxelles, André Versaille Editeur, 2013) et Palestine 1921, traduction du néerlandais par Nathan Weinstock, Paris, L’Harmattan, 1997. Il s’agit, autrement dit, de textes assez éloignés des romans du début du XXe siècle. Ceci même si l’homosexualité demeure un thème sur lequel le Néerlandais revient et si la production de ses dernières années traduit une fébrilité qui ne l’aura finalement jamais laissé en paix. De Haan avait une sœur philosophe et romancière renommée, Carry van Bruggen (1881-1932) dont deux œuvres sont disponibles en français, en particulier le roman Eva.
Pijpelijntjes ou un Ménage à deux
Début du XXe siècle. Toujours à court d’argent, Joop (sobriquet tiré du prénom de l’auteur : Jacob) et l’étudiant en médecine Sam (surnom d’Aletrino) partagent une chambre dans l’un des quartiers récents et populaires d’Amsterdam, De Pijp (La Pipe, celui où Jacob Israël de Haan s’est lui-même établi en 1903, sa logeuse de l’époque ayant un patronyme proche de celui qu’il donne à celle de son roman). Bien des rues portent des noms de peintres du Siècle d’or ; mais en lieu et place de couleurs et de renommée, c’est plutôt la pauvreté et la grisaille qui déterminent le quotidien des habitants : prolétaires, voyous, veuves et orphelins, petits cireurs de chaussures, rapins, rimailleurs…
A. Aletrino
Si les deux jeunes hommes se font passer pour des camarades, ils sont en réalité amants, des amants fragiles qui se querellent souvent. Le dépressif Joop est le plus féminin des deux. Quant au bisexuel Sam, il se montre extrêmement sadique, n’hésitant pas à frapper son ami. À l’occasion, ce dernier tombe amoureux de jeunes garçons tandis que Sam assure qu’il reste attaché à Joop et à personne d’autre. Cependant, il envisage bien de se marier un jour et de mettre donc un terme à leur liaison.
Chassés pour ainsi dire par leur logeuse, les deux amants finissent par trouver une nouvelle chambre en sous-location, toujours dans le même quartier (dans la rue, d’ailleurs, où Jacob Israël de Haan habitait). Leur nouvelle logeuse, Mme Meks, n’est guère favorisée par le sort : de temps à autre, il lui faut se rendre à la prison de Haarlem où est détenu son mari ; de plus, elle perd bientôt son chien. En réalité, Sam, qui déteste l’animal, le noie. Il va rééditer son coup avec le chien d’une autre femme. Cependant, il arrive à Mme Meks de vivre des moments plus gais. Elle reçoit chez elle, en particulier pour le rituel du thé ; la libération d’un complice de son mari sera aussi l’occasion d’organiser une petite fête.
Entre oisiveté, cafard et pleurs, mais aussi plusieurs mensonges, Joop éprouve les pires difficultés à sortir de ses pensées un garçon dont il s’est épris. En proie à des troubles psychiques, il ne peut cependant s’empêcher de tomber amoureux d’autres hommes plus ou moins jeunes, par exemple d’un ami de Sam. Un jour, il va même jusqu’à ramener une de ses conquêtes sous le toit qu’il partage avec son amant. Le garçon ne s’éternise toutefois pas. Joop éprouve une prédilection pour les adolescents tout en se disant réellement attaché au seul Sam. Mais ne voilà-t-il pas que celui-ci tombe amoureux d’une certaine Tonia ! C’est cette femme qui vient vivre avec les deux amis. Mais alors qu’il a réussi ses examens, Sam va connaître un sort tragique.
Les romans de Jacob Israël de Haan constituent sans aucun doute le sommet de son œuvre. On range Pijpelijntjes dans la mouvance naturaliste (souci de mettre en avant des réalités sans les édulcorer) tout en soulignant que l’écriture, marquée dans les dialogues par le parler populaire d’Amsterdam, se caractérise en outre, principalement dans les descriptions, par une palette impressionniste et un recours à la langue artiste de la fin du XIXe siècle. D’ailleurs, dans ces pages, malgré une facette misérabiliste, les traits décadents ne manquent pas : esthétique qui mêle douleur et jouissance, scènes sadiques, plaisirs d’autant plus raffinés qu’il sont stimulés par deux protagonistes « nerveux »…
De Haan et sa sœur Carry van Bruggen
Au fil des 24 chapitres, l’auteur nous propose une suite de scènes tirées de la vie du peuple, l’amitié singulière entre Sam et Joop fonctionnant comme un fil rouge. La façon dont ce couple se manifeste ainsi que certains choix de l’écrivain (Joop est à la fois l’un des « il » et, à d’autres moments, le « je » ; alternance surprenante des temps ; phrases dans un style télégraphique, sans verbe ou sans sujet ; nombreux points de suspension, etc.) constituent les points forts de cette narration. Celle-ci se distingue d’ailleurs par l’absence d’instance omnipotente. Elle se différencie de la teneur de certaines œuvres d’Eekhoud qui mettent en avant certains idéaux et l’élévation de l’esprit que peuvent inspirer des homosexuels. Pour sa part, De Haan se satisfait d’une réalité crue, en rien enjolivée.
On interprète généralement le titre énigmatique au sens de « scènes du quartier De Pijp » tout en relevant éventuellement une allusion à la fellation. Dans la version retouchée de son roman, J.I. de Haan a placé en épigraphe quelques vers de Catulle :
Je vous enculerai, vous sucerez ma queue,
(traduction de Lionel-Édouard Martin)
Vous avez lu mes vers, assez pour vous fonder
À me croire impudique : ils sont licencieux.
Un poète bien sûr doit être chaste et pieux,
Mais pourquoi faudrait-il que le soient ses poèmes ?
Georges Eekhoud
Autrement dit, il revendique une esthétique qui prévaut face à toute forme de morale. Le Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen de Magnus Hirschfeld – périodique alors en vue quant à la question de l’homosexualité – reprend quelques paragraphes de Georges Eekhoud, lequel défend une même approche. Dans une lettre à un autre confrère, De Haan expose sa visée première : « Si je parviens à dépeindre la misère de la vie qu’on mène dans ce quartier et les peines qui résultent de cette perversité de sorte à ce que lecteur les éprouve au fond de lui-même, cela voudra dire que je suis là où je veux être. » Si la thématique ne nous choque plus aujourd’hui, il faut reconnaître que l’écrivain néerlandais a fait preuve d’une audace surprenante ; on peut être surpris par certaines scènes « osées ». Dans Pathologieën, il a poussé les choses plus loin encore en décrivant les rêves incestueux d’un adolescent amoureux de son père.
Daniel Cunin
Ménage à deux (Pijpelijntjes)
Au bon A. Aletrino
(début de l’hiver 1904)
Chapitre 1. En quête d’une chambre
Il y a un temps pour venir, il y a un temps pour partir. Le moment pour nous de partir était arrivé. La Chopine en personne est venue nous le dire. On avait tout juste fini de manger. Du pain, un bout de fromage, du thé insipide… et il pleuvait. Nos doubles rideaux de dentelle trempaient dans la lessive, seuls les stores en tissu pendaient devant la fenêtre, carrés blancs, d’un blanc dur ; par instants, la lumière aqueuse du soleil lancinait crûment avant de tout à coup disparaître – lugubre.
Sam était affalé dans son fauteuil, mains ceignant son occiput et jambes tendues, yeux fermés. Il était peiné, je le regardais. La pluie tombait doucement.
C’est alors que la Chopine est entrée, ses vieilles pantoufles aux pieds, sans faire de bruit.
– B’jour, m’ssieurs.
– Bonjour, mademoiselle…
– M’sieur Sam se sent pas bien ?…
Plantée près de la table, elle a débarrassé, assiettes sur la boîte au pain et petit pot à beurre sur les assiettes. Sans ménagement, elle ébranlait le silence ; elle a tout regroupé dans son tablier-fourreau… puis d’une voix déterminée :
– Oui, m’ssieurs, faut qu’je vous dise, va y avoir du changement… va falloir vous trouver une aut’ chambre… j’va déménager…
– Comment, mademoiselle… comme ça, sans prévenir, au beau milieu du mois ?
– Au beau milieu du mois… euh, qu’est-ce qu’ça change ? C’est un loyer à la semaine, ici… Je m’en va lundi.
– D’accord, mademoiselle, mais on a loué au mois…
– Bah, Joop, te fatigue pas… elle va pas plus déménager que nous, mais bien sûr, elle veut louer à un meilleur prix… on va devoir vider les lieux. C’est correct.
– Non, mademoiselle, M. Sam a peut-être raison pour le reste, mais c’est pas très correct ça, je tiens à vous le dire.
– Pas correct… pas correct… qui parle de correction, on défend ses intérêts à soi, vous comme moi. J’arrête de t’nir une maison, j’va m’mettre en condition…
– En attendant, décampez de cette chambre !
– Enfin, je verra bien, M. Sam est encore de mauvais poil… mais au moins, vous v’là au courant.
Sam se recala dans son fauteuil, qu’il n’avait pas quitté. La pluie bruissait, le vent crécellait contre les vitres, étalant les épaisses gouttes sur le verre. Je les suivais des yeux. Le mauvais temps avait vidé les rues. Un chien aux toupets de poils mouillés s’était réfugié sous la charrette d’un porteur de pain, ce dernier, un gamin encore, sous un porche.
– Dis-moi, Sam, c’est à se taper sur les cuisses, déménager alors qu’on commence à être bien ici…
– On va pas déménager… on va rester tranquillement ici.
– Arrête, va pas faire d’esclandre… si elle veut se débarrasser de nous, on n’a pas le choix… j’arriverai bien à trouver autre chose…
– Moi, pas question qu’on me traîne sous la pluie… Rassure-moi, on va pas retourner habiter au-dessus d’une étable, hein… ?
– Non… bon, vaut mieux que je traîne pas.
– Ouais, c’est bien… j’ai mal au crâne, je vais me coucher…
– Alors comme ça, tu me laisses m’aventurer tout seul sous la pluie…
– Oh ! tu voudrais qu’on y aille à deux… reste ici… laisse tomber… on retombera bien sur nos pattes.
– Mon œil. À plus tard…
À peine étais-je devant la porte d’entrée que le vent m’accueillit de face. Voyons voir, d’abord quitter l’Ostadestraat… y a rien là. Ensuite, commencer par la Govert Flinkstraat, c’est toujours moins cher que la Jan Steenstraat ou que la Van Woustraat.
En même temps, ne pas se contenter de la première chambre venue… une à double alcôve ou bien une avec une seule alcôve et une petite chambre attenante… et pas de fauteuils en velours… avec petit-déjeuner… Bon Dieu ! saleté de pluie… Ah ! ce Sam, c’est quand même un personnage…
La Govert Flinkstraat, étroite et grise. À toutes les fenêtres ou presque, des annonces… chambre à louer, non, ça fera pas l’affaire… chambres meublées à louer. Allons jeter un œil, le temps d’égoutter mes habits… saleté de pluie.
Une seule cloche … amusant, il faut sonner deux fois ou trois en fonction de l’étage. C’est au premier. Pourquoi ne pas tirer dessus ?… une fois.
En haut, en retrait de la fenêtre qui s’ouvre, la pluie dissuadant une tête de s’avancer :
– Qui c’est ?
Quittant le porche, là où l’on est au sec, et m’adressant au premier :
– Madame, j’aimerais voir les chambres.
La femme scrute tout, du haut du chapeau mouillé au bas des jambes du pantalon usées et souillées.
– Sont d’jà louées.
– Mais votre annonce alors ?
– C’est pour d’autres… je loue à bien plus.
– Dans ce cas, j’aimerais bien les voir, ces autres chambres…
Fenêtre refermée. Avec un supplément de rage synonyme de : toi-dégage-d’ici, et rien d’un placide : je-viens-vous-ouvrir.
Y a plus qu’à se remettre en route.
La pluie empire encore… petite chambre à louer… cherche pensionnaires bien sous tous rapports… M’informer ici, histoire de me mettre à l’abri… un pensionnaire, on peut en parler plus longtemps que d’un simple locataire. Et ça ne mange pas de pain. Trois cloches cette fois. C’est au deuxième, un escalier qui monte tout droit, un deuxième en coude, tous deux sombres…
– Qui c’est ?… qui c’est ?…
– Je viens pour les chambres…
Un silence, mon manteau-cape et mon chapeau lourds dégouttent, dans ma tête une sèche sensation de fatigue, en face les habitations grises vibrent devant mes yeux brûlants… toute noire, la cage d’escalier bâille au-dessus de moi… la pluie persiste.
– Montez donc, maman a dit.
– Bien, mademoiselle.
En haut du deuxième escalier, penchée en avant, le regard plongé dans l’obscurité, une grosse jeune fille, figure joufflue et pâle, petits yeux humides, joues ballonnées.
– B’jour, monsieur.
– Bonjour, mademoiselle… votre maman m’a dit que je pouvais monter.
– Maman est dedans, piaule la mafflue, avancez donc.
Dans la pièce, la mère occupe un fauteuil. Maigre, cheveux noirs clairsemés, grisonnants.
– Assoyez-vous, m’sieur. Jansie, prends-y la cape au m’sieur, mais mets pas d’eau partout… assoyez-vous ici… j’suis un peu sourde… accroche-la bien, Jansie… voilà, comme ça on peut parler… autrement ça va faire des traces… vous permettez que j’continue mon ouvrage ?
La mère ravaude un bas. Une chiffe luisante vert foncé tendue sur un petit crâne sans oreilles, un grand trou dans la semelle croûteuse, et, dépassant des jupes, un pied d’un gris douteux aux ongles noirs.
– Alors, vous v’nez voir les chambres ? demande sourdement la vieille, ses paroles en cadence avec l’aiguille à repriser.
– Oui, madame… pour mon ami et moi.
– Ah, je vois… deux monssieurs célibataires, ça nous irait très bien, vous comprenez, moi veuve avec une fille unique, y manque toujours quèque chose chez soi…
Les joues mafflues se gonflent sans rougir, les yeux humides surveillent le poêle.
– Voyez-vous, c’est pas qu’on est tant à l’aise, juste cette pièce-ci et la chambre à coucher de moi et ma fille… oui pis encore un cagibi à charbon. Mais au grenier, on a fait mett’ une cloison, une p’tite chambre bien mignonne… du joli papier au mur…
Le poêle chauffe, une chaude indolence ouate les lieux… la voix de vieille mère-jabote semble marteler des mots venus de loin… suis fatigué, somnolent, mes habits mouillés dégagent une épaisse vapeur…
– … un p’tit tableau… vous d’vinez l’effet, toute façon Jansie pourra vous montrer tout à l’heure.
L’indolente chaleur m’assoupit… dans mes yeux brûlants de fatigue, tout se fait lourd, s’estompe… la vieille a terminé son ouvrage, elle s’empresse d’enfiler le pied gris sale dans le bas.
– Vous vous y sentirez comme un fils d’la maison…
La pluie harcèle les vitre embuées…
– Certes, madame, mais je veux prendre le temps d’y réfléchir, et y faut que j’en parle à mon ami…
– Vous voulez pas d’abord la voir, la chambre ?…
– J’ai peur, madame, que ça soit trop petit pour nous… pour moi, c’est pas gênant, mais mon ami, lui, est étudiant…
– Maman, si te plaît, pas des étudiants, autrement, not’ nom circulera tout de suite dans la rue.
– Vous êtes aussi étudiant, m’sieur ? jabote la vieille tout en se penchant pour ôter son autre bas avant de le passer sur l’œuf, la question encore affichée sur son visage fripé. Jansie, r’garde voir si le charbon a déjà brûlé.
– Moi ? Non, madame…
– Eh ben, Jansie, t’as entendu c’que m’sieur a dit ?
– J’vous tiens au courant… madame, si vous…
– Oubliez pas vot’ cape, m’sieur…
– Non. Si vous voulez…
– Jansie, la traîne pas contre l’mur, autrement tu vas tout me salir mon couloir….
De retour dehors par ce sale temps… un peu plus loin. Il est déjà onze heures et demie… les écoles se vident, les garçons poussent des cris, pans de leur cape ou de leur manteau soulevés, le vent gonflant ces voiles et agitant leurs knickers en tricot… quelques autres s’éclaboussant de l’eau boueuse des caniveaux. Et à proximité de l’école, chambres à louer. Au premier, une habitation bien entretenue, au rez-de-chaussée, en demi-sous-sol, une crémerie-fromagerie, rien dans le reste de la maison. Pourquoi ne pas sonner ?
– Qui c’est qu’est là ?
– Pour les chambres… madame.
Un petit rire tinte… d’une autre pièce un autre petit rire qui tinte ; appuyées sur la balustrade quatre filles et leurs rires qui tintinnabulent, s’alternent et se répondent…
– Oh, Joliette… un monsieur pour les chambres… Odette, ça te va à toi… mais non, mais non[1].
Du haut de l’escalier, une verrière jette de la lumière derrière moi.
– Montez donc, m’sieur, ah ! mais non*… les chambres sont déjà louées.
Toujours en bas, je comprends et voilà que le vent s’engouffre par la porte d’entrée.
Puis une fine voix de fausset, et une autre et une autre encore…
– Vous ne voulez pas voir les chambres… par nuit et par jour… mais Joliette… c’est pour toi Odette*…
De retour dans la rue. Pluie, vent qui gronde, sans relâche, les cartons des annonces mouillés… demande pensionnaire bien sous tous rapports… petite chambre à louer… chambres meublées à louer… numéro 254, premier étage… en dessous, un marchand de fruits et légumes, trois cloches. C’est bien, y a qu’à entrer.
Une femme, un vieux bonhomme, deux gosses. Relents de pisse.
– C’est moi, papa… papa y a un m’sieur pour les chambres… suivez-moi m’sieur.
C’est à l’arrière. Une grande chambre bien éclairée, une double alcôve.
– C’est pour vous seul, m’sieur ?
– Non, madame, pour un ami et moi, mais une chambre avec une alcôve peut aussi faire l’affaire.
– Comment vous la trouvez, la chambre ?… regardez, d’ici on a une belle vue sur les jardins de la Jan Steenstraat…
– La chambre est très bien, mais vous comprenez, j’dois d’abord en parler à mon ami… il aura sans doute envie de la voir lui aussi…
– Oui, m’sieur, mais j’peux pas attendre, y a quelqu’un d’autre qu’est intéressé, il vient demain après-midi donner sa décision.
– Eh bien, vous savez quoi ? je vais la prendre, mais ce que je voulais dire, comment sont les voisins ?
– Oh, pour ça y sont très bien… mais à propos, m’sieur, vous oubliez pas la caution, hein ?
– Non, bien sûr, c’est combien ?
– Quatre florins, m’sieur.
– Quatre florins ? C’est pas donné.
– Comment vous dites ?! Le loyer, c’est quinze florins pour un et dix-huit pour deux. Une semaine de loyer pour la caution, c’est la règle, en plus, quatre florins, c’est même pas une semaine.
Paie, il te restera neuf stuivers[2].
– Bien, alors j’va enlever l’annonce… au revoir m’sieur… vous venez quand ?
– Lundi, je pense, mais peut-être dès samedi… comptez plutôt sur samedi, c’est mieux, puisque c’est pas meublé… au revoir madame…
– Au revoir m’sieur.
Ya plus qu’à vite rentrer, c’est déjà midi passé… ne pas oublier d’acheter cent grammes de saucisse…
Satisfait, preste, sous la bruissante pluie qui continue de faire rage. Cape qui se fait lourde sur le bras, veste trempée.
Sam est vautré sur quelques coussins, par terre, les yeux dans le vague.
– Salut !…
– ’jour… déjà de retour ?
– Déjà de retour ?… J’suis trempé comme une soupe !
– Y pleut toujours ?
– Et pas qu’un peu. T’as dormi ?
– Ouais… somnolé. Maintenant que tu l’dis, la pluie, je l’entends… t’as trouvé ?
– Ouais, une très belle piaule avec une double alcôve, rien que ça, pour dix-huit florins, pas cher hein ?
– Non, c’est bien, on s’y installe quand ?
– J’pensais à samedi… dis-moi, Sam, j’en ai bien bavé, embrasse-moi.
– Qu’est-ce que tu crois ?…. sers-toi si t’en as envie…
Et vers le visage hâlé de Sam, je me penche. Avec souplesse, il arque la poitrine et me gifle les yeux… ce qui fait jaillir juste devant moi une lumière blanche, blanc jaune.
– Là… là…
– Eh… nom de Dieu de bon Dieu !…
traduit du néerlandais par Daniel Cunin
[1] L’astérisque qui suit un passage en italique renvoie à une suite de mots en français dans le texte.
[2] Le stuiver était une pièce de 5 cents, soit 1/20e de florin.
Dit stuk en deze vertalingen verscheen eerder op het blog Flandres-Hollande van Daniel Cunin

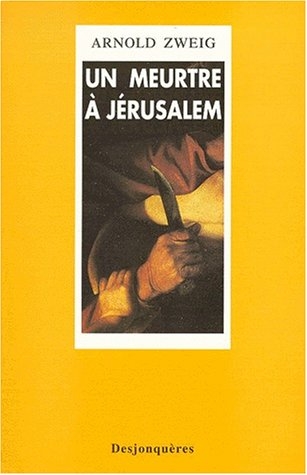
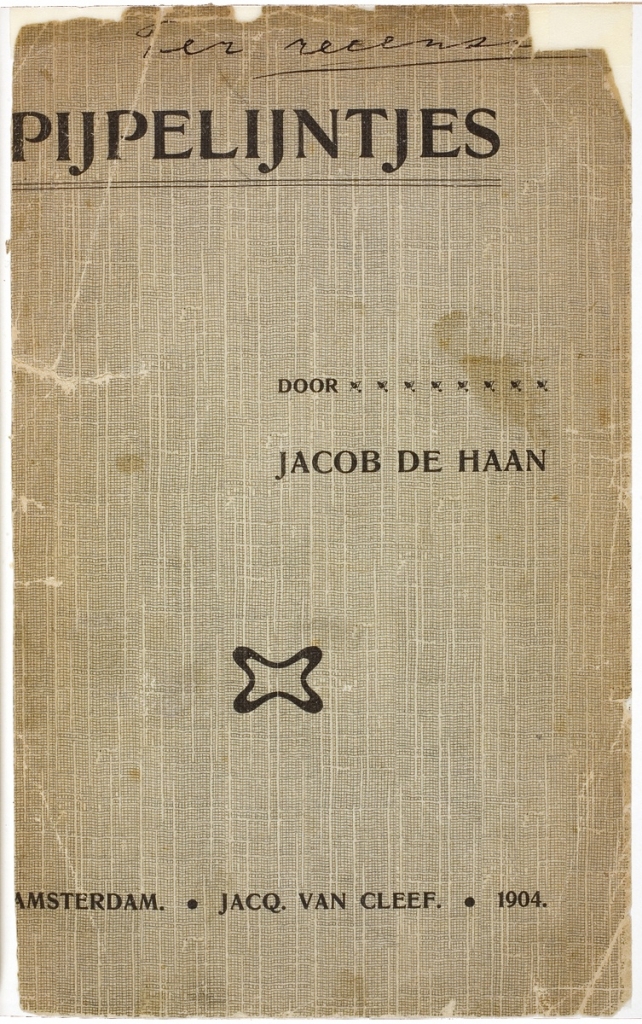






Laat een reactie achter